
Quand j’étais petit, j’ai joué à Badaboum ! C’est un vieux jeu de société distribué par la société Capiepa dans la seconde moitié du 20e siècle, et que mes parents avaient acheté. Les règles sont simples : trois joueur.se.s doivent empiler chacun.e à leur tour des pièces en bois, aux formes diverses et variées, sans faire tomber la pile qui se forme.
Ce jeu est une antiquité et je pense qu’il est largement tombé dans l’oubli, mais le principe est assez simple à appréhender. Vous pouvez vous le représenter comme un “Jenga” à l’envers : au lieu d’enlever des pièces en bois, on en ajoute à une “tour” improvisée.
Justement, venons-en à l’improvisation ! Dans la série “Improviser, c’est comme”… Je pense qu’on peut comparer de façon intéressante l’improvisation théâtrale à une partie de Badaboum ! Voilà pourquoi :
On ne crée une tour qu’en empilant sur les pièces des autres
Si tu poses ta pièce sur le sol à côté de celle qui vient d’être posée, tu ne joues pas au jeu. Cela ne présente aucun intérêt.
En impro, c’est le même principe. Cela correspond à la règle du “oui et”, dont je parle dans cet article, cet article ou encore cet autre article.
C’est la règle de base, qui rend l’histoire commune possible : chaque comédien.ne apporte une brique à l’histoire en jouant en cohérence avec ce qui a été posé précédemment par les autres comédien.ne.s.
Comme expliqué dans les articles cités plus haut, et comme l’explique dix fois mieux Patti Stiles dans son ouvrage Improvise Freely, il ne faut pas se méprendre sur l’objectif “d’ajouter une brique” : l’accumulation d’une pile d’éléments narratifs n’a que très peu d’intérêt.
En effet si l’on fait cela, l’histoire ne cesse de changer de direction, sans construire des enjeux intéressants pour le public. Il est largement préférable d’exploiter le ressort narratif qui est déjà là dès les premières secondes de la scène, sans se disperser inutilement. C’est la façon qu’a notre personnage d’être dans le monde qui constitue la “brique”, notre contribution scénique.
Ne rien dire, ne pas bouger, partir de scène, tout cela peut constituer une “brique” pertinente. Tout dépend des briques précédemment posées par les autres comédien.ne.s, ou que l’on peut deviner.
On se retrouve à doser son déséquilibre
Quand on joue à Badaboum, on doit faire preuve d’une gestion stratégique de l’équilibre : si on pose un élément stable sur la pile, on ne met pas ses adversaires suffisamment en risque : il y a peu de suspense (et on s’expose à une contre-attaque). Pour bien jouer, il faut donc poser une pièce de façon à ce qu’elle soit au bord du déséquilibre, ou suffisamment biscornue pour rendre la pose d’une autre pièce plus ardue. Bien sûr, si l’on pose sa pièce trop au bord ou dans une position trop incongrue, elle risque de tomber et faire s’effondrer toute la pile, précipitant notre défaite.
Un.e joueur.se de Badaboum doit donc finement doser le positionnement de ses pièces, pour générer assez de risque sans faire s’écrouler le tout.
En impro, nous retrouvons exactement ce principe avec la notion de “cercle des attentes”. J’en ai un peu parlé dans mon article sur les 10 commandements de l’impro. Quand on établit une première série d’informations, tout un univers est logiquement « attendu » par le public. Si la suite de l’improvisation ne s’inscrit pas dans le cadre de cet univers, on aura posé notre pièce complètement à côté de la pile, et on n’aura pas répondu aux attentes du public. Constatant que souvent les improvisateur.ice.s essaient désespérément d’être originaux, quitte à ruiner les attentes qu’iels posent en début de scène (en changeant complètement d’univers, en indiquant que finalement les personnages se foutent complètement de quelque chose qui semblait hyper important quelques secondes plus tôt, etc), Keith Johnstone était connu pour demander à ses élèves de rester “évidents”.
Nabla Leviste indique dans son ouvrage La fabuleuse science de l’imprévu qu’il est intéressant de viser la bordure de ce “cercle des attentes”. Il rappelle qu’il faut toujours rester cohérent, honorer les promesses que l’on établit en début de scène, mais que le plaisir de l’improvisation réside tout de même dans le fait de surprendre ses camarades et le public. C’est cette zone frontière, au bord du déséquilibre, de l’incohérence, qui constitue l’espace des scènes mémorables.
Afin d’atteindre cette zone, on peut adopter deux approches différentes :
- si nos impros ont tendance à tourner en rond et reposer sur des clichés, on peut s’entraîner à chercher l’angle original pour traiter un thème qui sinon reste attendu ou rebattu ;
- si nos impros ont tendance à être absurdes, incohérentes et avec des personnages sans implication émotionnelle, on peut au contraire rechercher l’évidence, l’attendu, et laisser organiquement la première étrangeté venue emmener la scène vers le mémorable.
En cas de doute, préférez la seconde approche. Conseil d’ami 😉
Le moment de la chute dépend entièrement des pièces posées par les joueurs et joueuses
Une manche de Badaboum peut avoir une durée très variable. C’est souvent assez court mais parfois la pile peut s’effondrer en quelques secondes, après un tour seulement ! La durée d’une manche de Badaboum dépend entièrement des choix faits par les différent.e.s joueur.se.s.
En impro, c’est une logique similaire. Sauf dans des formats où le temps est imposé (le match par exemple), la durée d’une scène ne saurait être prédéfinie. La scène durera le temps qui lui est nécessaire, c’est-à-dire une durée qui résulte de la dynamique qui se construit puis se dénoue entre les personnages.
Certains formats de spectacles s’amusent autour de cette plasticité de la durée des scènes : dans le spectacle Trente, les artistes sont encouragés à varier les plaisirs en alternant des scènes longues (avec des enjeux narratifs plus complexes) et des épisodes improvisés durant parfois quelques secondes : une petite blague est faite, rien de superflu n’est nécessaire, on passe donc à la suite !
Badaboum ! C’en est fini de cet article ! Vous pouvez reprendre une activité normale (un petit jeu d’adresse par exemple ?).
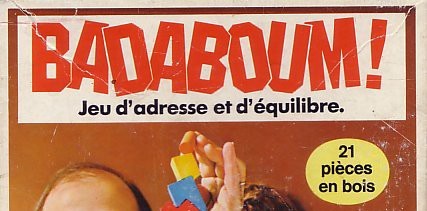
Laisser un commentaire